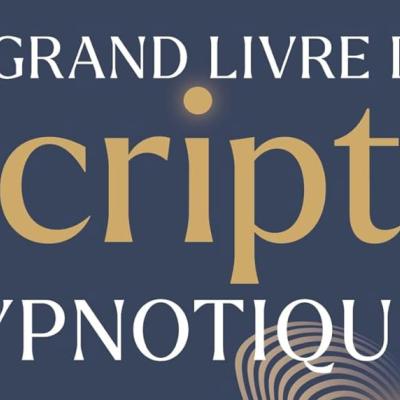Quand est-ce que l’on fait vraiment de l’hypnose?
Cette question, fréquemment posée, mérite que l’on s’y attarde un peu. Elle est en effet légitime : parfois, on passe de façon fluide d’un échange simple à un temps d’hypnose sans marqueurs formels du changement de registre. Egalement, il arrive que l’on commence un temps d’hypnose, mais le patient ne présentant pas de signe évident de transe, on se demande si le processus est bien à l’œuvre. Alors, quels repères se donner pour avancer?

Par 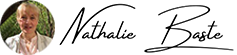
Une séance d’hypnose, pour tout praticien, commence dès que celui-ci entre en relation avec le patient, et avant même l’induction formelle de l’état hypnotique. Il s’agit d’une phase d’échange initial, qui joue un rôle essentiel dans la mise en confiance, la clarification des attentes, et la préparation psychologique à l’expérience hypnotique. Par contre, lorsque nous parlons du début formel de la transe hypnotique, celle-ci commence à l’instant où le praticien fait la première induction hypnotique. Donc, notre question exige deux niveaux de réflexion, un premier d’un point de vue relationnel, et un deuxième d’un point de vue technique.
D’un point de vue relationnel, la séance d’hypnose commence dès la première interaction, lors du premier regard dans la salle d’attente ou même lors du rendez-vous téléphonique. L’hypnose est tout autant, voire plus, une relation qu’un état. Pour cette raison, les processus s’activent de suite. Notamment, l’alliance thérapeutique repose sur une relation de coopération, et d’engagement des deux côtés. Celle-ci demande de s’accorder sur les objectifs et sur les tâches à accomplir. Cette alliance thérapeutique est indispensable pour que le patient soit en sécurité (la base de tout temps hypnotique), et pour qu’il fasse confiance aux processus hypnotiques. Puis, le thérapeute s’ajuste en adaptant son langage, le ton de sa voix, ses silences, et son rythme au patient. Il ne s’agit pas d’induire une transe de façon formelle pour que la première interaction soit hypnotique, mais de créer un contexte propice à l’hypnose. Pour cela, le praticien peut activer immédiatement quelques leviers. Il est garant de l’espace de sécurité, dans le calme, l’écoute active et la reformulation si nécessaire. Le langage hypnotique peut être formulé au fil de l’eau, saupoudré de façon plus ou moins directe ou floue. Il peut orienter l’attention et les attentes du patient en lui montrant que la dynamique de changement est déjà en route. Enfin, il permet la mobilisation des ressources du patient en lui permettant de se reconnecter à ses capacités.
D’un point de vue technique, l’hypnose commence à la première induction. Le praticien perçoit le moment où il peut initier l’induction hypnotique. Celle-ci permet au processus de guider le patient vers un état de conscience modifiée, vers une transe hypnotique. L’induction hypnotique demande une focalisation de l’attention de l’extérieur vers l’intérieur de soi. Suivent les phases d’approfondissement et le travail thérapeutique propre à chacun.
De tous les points de vue, nous commençons à faire de l’hypnose avant l’induction, pendant, et après celle-ci. La dynamique hypnotique se met en place dès qu’une relation s’établit entre un thérapeute et un patient dès lors qu’une intention d’hypnose est présente.
Ainsi, pour répondre pleinement à la question « Quand est-ce qu’on fait vraiment de l’hypnose ? », la formation proposée par Ipnosia adopte une approche intégrative, à la fois rigoureuse et sensible, qui invite les praticiens à penser l’hypnose comme un continuum d’expériences plutôt qu’un événement délimité. Dans cette perspective, il ne s’agit pas tant de fixer un point de départ absolu que de développer une capacité fine à repérer les indices du processus en cours, qu’ils soient subtils ou manifestes.
La méthode mise en place par Ipnosia insiste sur une double compétence à cultiver chez les praticiens en devenir : la compétence relationnelle d’abord, qui consiste à créer dès le premier contact une qualité de présence ajustée, une sécurité perceptible et une attention flottante capable de capter les mouvements internes du patient. Cette dimension relationnelle est travaillée à travers des exercices de synchronisation, d’écoute active incarnée, et de reformulation évocatrice, dans des mises en situation qui visent à aiguiser l’intuition clinique. On y apprend à reconnaître que l’hypnose s’infiltre dans les interstices de la relation, bien avant toute induction formelle.
La compétence technique est, quant à elle, abordée comme un art de l’ajustement, où les scripts ne sont jamais figés mais vivants, adaptables, portés par la sensibilité du praticien à ce qui se joue dans l’instant. Le moment de l’induction est envisagé non pas comme un début, mais comme une intensification d’un processus déjà amorcé, une manière d’orienter davantage l’attention vers l’intériorité, vers la résonance symbolique, vers le corps senti. Les exercices proposés dans le cadre d’Ipnosia permettent aux praticiens de s’approprier cette finesse de modulation entre conversation ordinaire et transe émergente, en apprenant à « écouter les seuils », ces moments de bascule souvent imperceptibles où le langage cesse d’informer pour commencer à transformer.
La pédagogie d’Ipnosia repose donc sur une conception non dualiste de l’hypnose, qui refuse de la limiter à des phénomènes visibles ou à des états profonds, et qui préfère cultiver chez les praticiens une sensibilité au rythme de l’instant, à l’intention partagée, à la plasticité du dialogue thérapeutique. Dans cette optique, « faire de l’hypnose », ce n’est pas appliquer un protocole, mais habiter une posture d’écoute et de création, capable de s’ouvrir aux possibles de la rencontre et de suivre le fil du vivant qui se tisse entre deux présences.
C’est pourquoi, chez Ipnosia, nous transmettons non seulement des outils, mais aussi une manière d’être ; une hypnose qui se vit autant qu’elle se pratique, une hypnose qui commence dès l’accueil et se prolonge bien après la fin de la séance.