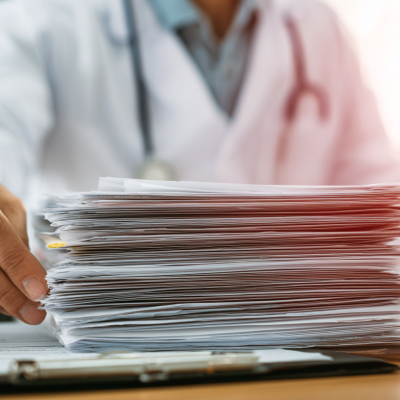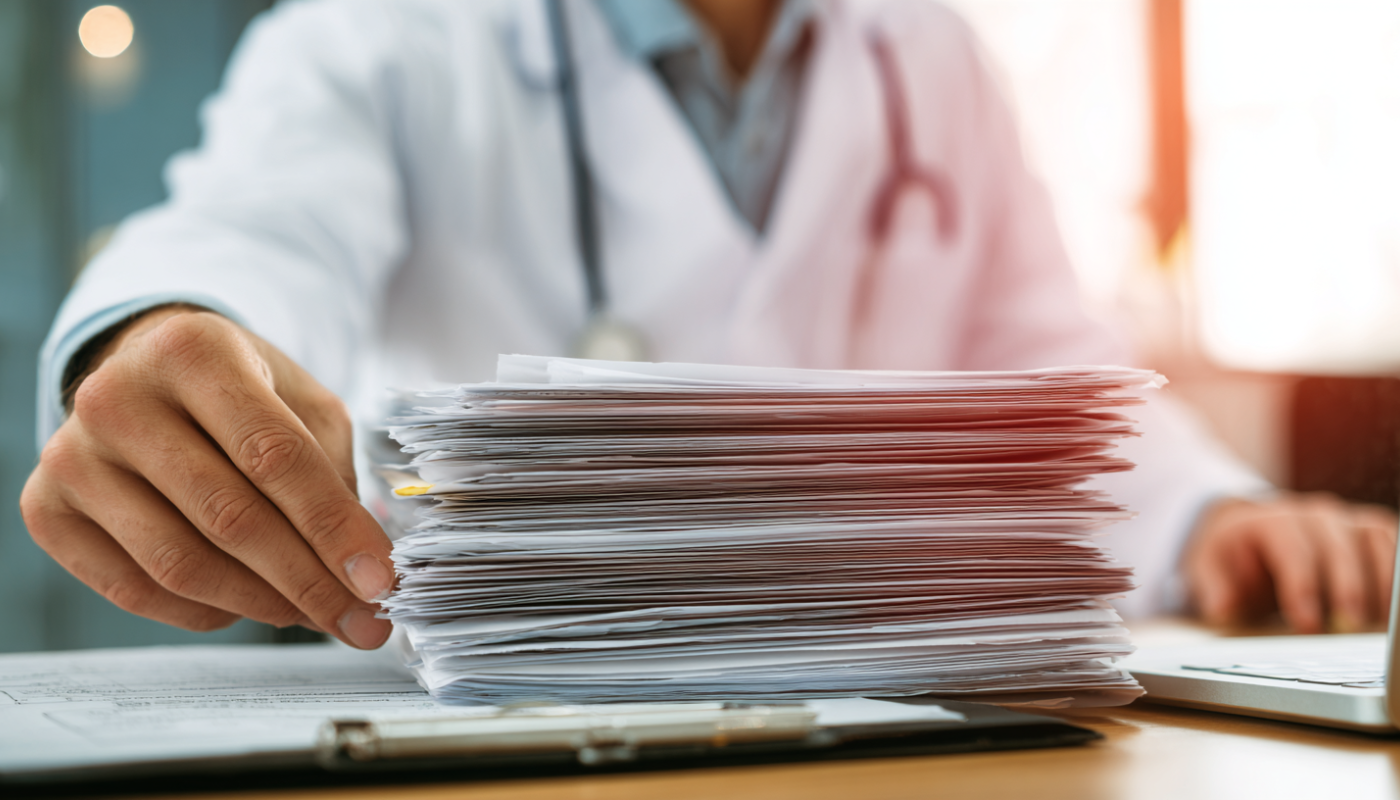« Et là, j’ai peur d’aller trop loin avec l’hypnose ».
Cette phrase, nous la recevons régulièrement en supervision de pratique, soit au cours des formations, soit dans les accompagnements de praticiens plus experts. Et elle est légitime. Dans toute séance d’hypnose, il y a un moment où quelque chose se déplace. L’attention du patient se resserre, son monde perceptif s’active, et la voix du thérapeute devient une présence plus proche, plus enveloppante. Ce déplacement, souvent imperceptible, constitue le cœur du processus hypnotique. Mais c’est aussi le moment où la responsabilité éthique du praticien s’intensifie.

Par 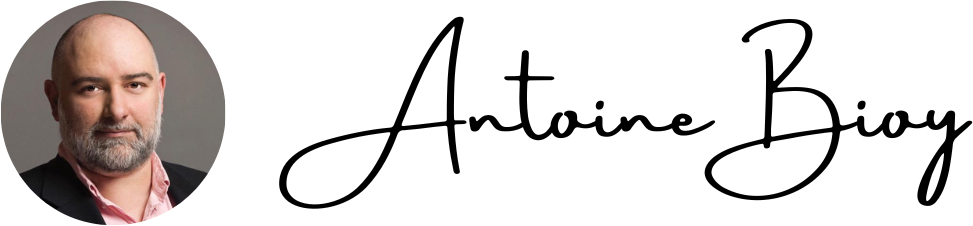
Parce qu’elle engage la suggestibilité des patients et installe un flou entre réel et imaginaire, l’hypnose implique un type particulier d’influence - non pas celle du pouvoir, mais celle de la résonance. Et c’est Sigmund Freud qui le premier souligna cette dimension impliquant à la fois la clinique et l’éthique, reprise plus tard par Roustang, au sein de sa propre conceptualisation. Nous avons maintenant intégré que cette influence agit au niveau de la perception, des émotions et du langage intérieur (l’intralocution dont parle Thierry Melchior). Et cela implique que la question du consentement doit être pensée en hypnose comme un processus vivant, continu, partagé. Le consentement n’est pas un pouvoir, c’est une modalité de relation. Et c’est précisément parce qu’elle agit au cœur de la perception et de la conscience qu’elle exige une vigilance éthique continue. L’enjeu n’est pas seulement de « ne pas nuire », mais de maintenir vivant le consentement, de faire de chaque suggestion un acte de respect.
Le consentement, en hypnose, ne se donne pas une fois pour toutes : il se rejoue sans cesse. Avant la séance, bien sûr, il y a le temps de l’explication : annoncer le processus, dire que l’hypnose modifie l’attention sans abolir le contrôle, rappeler que l’on peut rouvrir les yeux, parler, arrêter à tout moment…
Et ensuite, tout commence vraiment : un dialogue de micro-signes, que l’on apprend lors des formations Ipnosia à reconnaitre, par lesquels le patient dit « oui » ou « non » de façon délicate. Ce consentement est un mouvement - une danse de présence et d’écoute. Il se lit dans le souffle, le tonus, le rythme de la voix. C’est un « oui » qui respire, un « non » qui se dessine, une confiance qui se construit par ajustements successifs. Être thérapeute, c’est ici apprendre à sentir ces inflexions, à percevoir le moment où la coopération s’essouffle, où l’attention se retire. Le praticien n’est pas celui qui obtient le consentement, mais celui qui le préserve. C’est une responsabilité fine, presque invisible : maintenir la liberté de l’autre jusque dans la profondeur de la transe.
La bienfaisance : influencer pour servir
Toute suggestion hypnotique est un mouvement de persuasion. Elle oriente l’attention, ouvre une direction nouvelle, déplace parfois une émotion enfouie.
C’est un geste thérapeutique, mais aussi un acte moral : à quoi correspond ce mot que je vais prononcer ? La démarche éthique commence par cette question. Se demander si ce que l’on propose à l’autre est bien en accord avec les objectifs, avec ce que l’on perçoit des besoins et aussi des ressources de l’autre. On peut bien entendu observer les signes du patient pour continuer ou ajuster (front qui se plisse, mouvement d’une main…). On peut aussi demander un signaling : « lorsque vous serez prêt à poursuivre, vous pourrez me le faire savoir en laissant un doigt de la main droite se soulever ». On peut également intégrer une vérification dans un exercice : « à mesure que vous sentez la voie qui vous permet en confiance et en sécurité de poursuivre, vous pouvez ressentir vos deux mains qui se rapprochent. Et plus elles le font, plus l’espace de votre douleur s’allège ». Et là aussi ajuster si le signe attendu ne vient pas, et notamment en posant la question au patient « décrivez moi ce que vous ressentez… quelque chose peut-il être encore fait ou sentez vous que nous pouvons en rester là? »?
La suggestion n’est pas neutre : elle doit toujours être au service d’un objectif de santé clair et partagé. Elle ne vise pas à imposer une solution, mais à soutenir le mouvement vers une situation autre, souhaité plus adapté à la santé, et aussi favoriser la capacité du patient à se mobiliser pour lui-même.
L’hypnose devient alors un accompagnement du mouvement naturel du sujet vers sa propre cohérence.
Chez les personnes vulnérables, cette exigence s’intensifie encore. La dissociation lorsque mal ajustée, la fragilité émotionnelle, le besoin d’attachement peuvent transformer la transe en dépendance. Ici, la supervision clinique du praticien, la prudence en lien avec ses savoirs et son expérience, la co-construction sont des conditions de sécurité clinique. L’éthique de la bienfaisance ne consiste pas à « vouloir faire du bien », mais à savoir quand notre bien risque de ne plus être celui de l’autre.
La checklist du praticien : trois gestes de conscience
On l’aura compris, l’éthique ne se décrète pas : elle se pratique. Elle se manifeste dans les détails, dans les gestes discrets du soin.
Trois repères simples peuvent aider à la cultiver que nous transmettons lors de nos formations Ipnosia. Une checklist du praticien, non pas comme une procédure, mais comme une forme de vigilance consciente.
- L’intention déclarée : dire où l’on va
Toute séance commence par une orientation claire. Dire : « Aujourd’hui, nous allons travailler à mieux gérer la douleur », ou encore : « Nous allons explorer ensemble une manière d’apaiser votre sommeil » est aussi simple que nécessaire. Pas simplement d’ailleurs pour l’éthique, mais aussi pour faciliter l’ajustement du patient à ce qui va suivre, s’il le souhaite.
« Dire » n’est pas une formalité, c’est un engagement mutuel. La parole explicite ouvre un espace de confiance, elle définit un cadre connu et prévisible.
Le patient sait pourquoi il entre dans la transe, et le praticien se rappelle qu’il n’y conduit pas au hasard.
Nommer l’intention, c’est déjà un acte d’éthique : cela rend visible ce que l’on cherche à faire, et à quoi l’on s’engage ensemble.
- La vérification continue : écouter avant d’agir
Une fois la transe installée, la vigilance prend une autre forme. Le thérapeute observe, écoute, ajuste. Le corps du patient devient le premier langage : respiration, micro-mouvements, inflexions du visage, changements de rythme. Ces signes ne sont pas des détails : ils indiquent la qualité de la relation, le degré d’accord, et parfois, de résistance. Cette dernière ne doit pas être contournée ; elle est plus un signal pour le thérapeute qu’il doit ajuster quelque chose et (re)valider avec le patient sa coopération et motivation à poursuivre. Comment faire? Par exemple ce que nous avons indiqué plus haut : signaling, acte de parole, intégration d’un signal qui « teste » le souhait de la personne de poursuivre ou non.
Cette écoute fine permet d’adapter en temps réel : ralentir une induction, reformuler une image, laisser un silence, redonner une intensité à la coopération avec le patient. Aussi, savoir s’arrêter est parfois la plus belle forme de respect. La vérification continue transforme la séance en une co-navigation : deux consciences qui avancent ensemble, prêtes à changer de cap si le vent de la relation tourne.
- La traçabilité : penser après avoir parlé
L’éthique ne s’arrête pas avec la fin de la séance. Noter ce qui s’est passé - le type de suggestions employées, les réactions observées, les ajustements effectués - permet de garder une trace consciente de notre support d’influence, et ainsi d’éventuellement le re-questionner par la suite. Cette traçabilité n’est pas un exercice bureaucratique, mais un outil de supervision individuelle.
Elle nous aide à repérer les glissements de posture, les habitudes, les phrases qui touchent juste ou qui dévient. Evidemment, cela peut aussi être discuté avec une « personne miroir » : un collègue expérimentée qui pratique également l’hypnose, en intervision de groupe, ou en supervision si besoin.
Relire ses propres notes, c’est revenir sur la relation avec lucidité, pour comprendre ce que notre parole a provoqué, permis, ou empêché. C’est une manière d’honorer la complexité du soin.
En institution, cette traçabilité n’a pas vocation à rester intime. Par exemple, la mise en place d’un onglet spécifique à l’hypnose dans le dossier patient informatisé est déjà présent dans plusieurs structures hospitalières. Cela facilite aussi le travail de liaison, par exemple entre une équipe de bloc et une équipe en salle de réveil qui souhaiteraient assurer une continuité dans l’accompagnement hypnotique. Bien pensé, il n’y a que des effets vertueux à cela !
L’éthique comme style de présence
On pourrait croire que ces précautions alourdissent la pratique. En réalité, elles l’allègent. Elles libèrent le praticien de la toute-puissance implicite, lui permettent d’habiter pleinement la rencontre sans craindre d’en abuser. L’éthique devient alors un style de présence : une attention incarnée à l’autre, une manière d’exercer la parole avec justesse.
L’hypnose n’est pas une technique de plus : elle soutient et enrichit l’art de la relation. Et cet art exige d’assumer la puissance du verbe tout en la mettant au service de la liberté du patient. Chaque mot devient un possible, non une injonction. Chaque silence devient une ouverture pour dire, non une zone de privation de la paroles. Cela s’apprend, et c’est la raison pour laquelle la formation à Ipnosia inclut le thème de l’éthique et du consentement dans les pratiques hypnotiques. Pas uniquement en théorie, mais aussi en pratique, lors des espaces de supervision avec nos formateurs experts.
Être praticien de l’hypnose implique d’accepter d’accompagner l’autre au seuil de sa propre conscience, sans jamais franchir la porte à sa place.
C’est influencer pour faire ressentir et parfois vivre combien le changement est possible. On cherche à le rendre désirable lorsque notre expertise nous guide vers cela, sans toutefois l’imposer. Et peut-être que toute l’éthique se résume à cela : une manière de rester témoin, attentif et présent, tout en laissant à l’autre la responsabilité de sa trajectoire, de son existence, de son corps impliqué dans une démarche en santé.
Parce qu’en définitive, l’hypnose n’est pas un acte d’emprise - c’est un acte de confiance. Ou plutôt… un état modifié de confiance, partagé, et qui nous oblige.